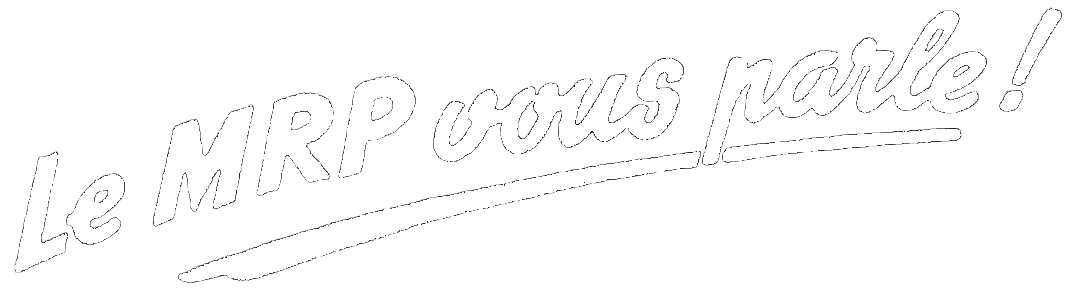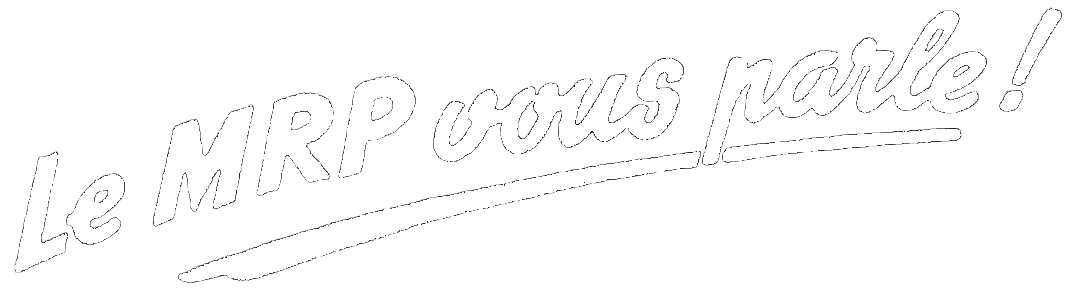|
ARCHIVES AG
Bulletin 4eme trimestre 2024
Le 5 septembre 2024,
le Président de la République nommait Michel Barnier Premier ministre. Dès le 7 septembre, Pierre Méhaignerie, se fondant sur son expérience à la fois locale et nationale, proposait dans une tribune publiée par le quotidien Ouest France quelques pistes pour répondre aux attentes des Français et au nécessaire redressement du pays confronté à des risques de crise institutionnelle et financière.
Concilier efficacité économique et justice sociale
« En ce mois de septembre 2024, les attentes sont fortes, en particulier pour :
- les 5 à 10 millions de foyers pour lesquels les fins de mois se jouent entre 50 et 100 euros ;
- les jeunes, qui doivent consacrer de plus en plus de leur salaire dans les loyers ;
- les familles qui sont en attente d'un logement social ;
- les salariés en zone rurale, à 30 ou 40 km de leur lieu de travail.
Pour répondre à ces attentes, on peut chercher à plaire avec des propositions démagogiques, ou on peut proposer des solutions efficaces, qui ont fait leur preuve.
Laisser croire que nous pouvons travailler moins, partir à la retraite plus tôt, tout en gagnant plus : cela ne marche nulle part dans le monde. Pire, une telle politique aggraverait dangereusement la situation du pays. Les mensonges peuvent être électoralement payants mais les réveils douloureux. Après l'arrivée du nouveau Premier ministre, les travaux parlementaires vont commencer. Des compromis doivent être recherchés pour concilier efficacité économique et justice sociale.
Plus de personne au travail et plus d'heures travaillées
A mon avis, notre situation économique exige que nous travaillions un peu plus. Chez nos voisins, le nombre d'heures travaillées par habitant s'élève à 700 heures par an, tandis qu'en France nous travaillons 640 heures en moyenne.
On sait que de nombreuses offres d'emploi restent insatisfaites. Le taux d'actifs en France est plus faible que chez nos voisins. Il n'y aurait que des avantages si, en France, il y avait plus de personnes au travail et plus d'heures travaillées. On peut le constater en examinant la situation dans certains territoires français, en Alsace, en Auvergne, et dans l'Ouest.
L'exemple du Pays de Vitré est intéressant. Le salaire moyen par tête se situe au deuxième rang des dix-huit zones d'emploi de Bretagne. Le revenu fiscal par foyer est supérieur à la moyenne nationale. Le niveau de pauvreté est faible (1% de la population bénéficie du RSA par rapport à la moyenne nationale de 3%). Les impôts locaux sont inférieurs de 20%.
Pourquoi ? Une plus grande proportion de la population travaille (le taux de chômage est de 3,7%). Des actions courageuses comme la réforme des retraites et l'incitation au retour au travail seraient largement acceptées si ces actions étaient accompagnées de mesures de justice : l'accroissement par étapes du Smic, un réexamen des conditions de retraite pour les carrières longues et les métiers pénibles, la suppression de nombreuses niches fiscales qui n'ont pas montré leur efficacité, et une tranche supplémentaire, tout à fait défendable, de l'impôt sur le revenu.
Tentatives de recherche de compromis
La situation du pays impose des recherches de compromis. J'ai vécu, comme président du Groupe centriste à l'Assemblée nationale, des tentatives de recherche de compromis, en particulier avec Michel Rocard, Premier ministre socialiste.
Les députés de mon groupe soutenaient de nombreuses réformes proposées par Rocard. La droite dure nous appelait des 'centristes félons' et, pour la gauche radicale, nous étions des 'faux culs au service du grand capital' !
Aujourd'hui, j'espère que l'intérêt du pays et la pression de l'opinion publique aboutissent à la
création de majorités sur des projets conciliant efficacité économique et justice sociale. »
Pierre Méhaignerie
Un nouveau gouvernement
Le Palais de l'Elysée a annoncé la nomination des membres du gouvernement de Michel Barnier le samedi 21 septembre 2024. Des nominations complémentaires ont été annoncées le vendredi 27 septembre. Parmi les personnalités nommées, six sont issues de partis politiques se rattachant à la famille centriste : trois viennent du Mouvement Démocrate (MoDem) et trois de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI).
Par ordre de nomination :
- Jean-Noël BARROT (MoDem), ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ; - Geneviève DARRIEUSSECQ (MoDem), ministre de la Santé et de l'Accès aux soins ;
- Valérie LETARD (UDI), ministre du Logement et de la Rénovation urbaine ;
- Françoise GATEL (UDI), ministre déléguée auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l'Artisanat ;
- Fabrice LOHER (UDI), ministre délégué auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, chargé de la Mer et de la Pêche ;
- Marina FERRARI (MoDem), ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, chargée de l'Economie du tourisme.
Jean-Noël BARROT Geneviève DARRIEUSSECQ Valérie LETARD
Françoise GATEL Fabrice LOHER Marina FERRARI
Nous les félicitons chaleureusement tous les six.
Point de vue
Quand un homme engagé en appelle au Président de la République... un vibrant plaidoyer pour un centre renouvelé, un éloge de la main tendue, de l'écoute, du dialogue et de la recherche du consensus.
Lettre à mon Président
Quelle pensée face au chaos tant redouté ? La nôtre est née à la fin du 19e siècle et a connu des expressions diverses : catholicisme social, démocratie chrétienne, doctrine sociale de l'Eglise, personnalisme communautaire, troisième voie, capitalisme rhénan, économie sociale de marché, droit romano-germanique. "Elle a lié des conjonctions, suscité des mutations voire des ruptures" a expliqué l'historien Jean-Marie Mayeur dans son ouvrage Catholicisme social et démocratie chrétienne (Editions du Cerf, 1986).
Elle interpelle tant les socialismes que les libéralismes, apportant des instruments d'analyse : une réflexion vivante et pluraliste, pas une pensée unique ! Cette conception de l'homme et de la vie en société peut rejoindre les croyants, les athées ou les humanistes des Lumières. Qui en aurait le monopole ?
Elle a résisté avec les armes sous le nazisme et avec l'esprit contre les modes et les facilités intellectuelles. Lorsque Jean-Paul Sartre fascinait la jeunesse en proclamant : "Un anti-communiste est un chien !", elle rappelait que chaque être est unique. Et l'histoire lui a donné raison puisque toutes les formations politiques, à l'exception des extrêmes, s'y réfèrent aujourd'hui : la primauté de la personne, l'importance des communautés intermédiaires - familles, écoles, entreprises, associations, syndicats, partis - à la place de l'Etat-providence et vertical, la subsidiarité pour déléguer à l'institution la plus performante, la solidarité qui n'est pas l'assistanat, la justice sociale qui est le contraire de la lutte des classes, la décentralisation sont devenues, au fil des décennies, des fondamentaux.
Et comment ne pas se souvenir du courage de celles et ceux qui militèrent pour l'Europe, au lendemain de la Seconde Guerre, proposant même sa propre défense, la Communauté européenne de défense (CED) qui, peut-être, nous aurait évité le drame ukrainien...
Les idéologies fascistes ou marxistes ont fait les malheurs du XXe siècle : la préférence de la race a aveuglé l'une, la préférence de la classe a envoûté l'autre. Ces tentations continuent de séduire, d'influencer, de manipuler les opinions, de susciter les rejets et les haines... Elles caricaturent et simplifient des problématiques complexes et insaisissables alors que la démocratie, c'est "développer au maximum la conscience et la responsabilité de chacun" pour reprendre la belle formule de Marc Sangnier.
Le centre n'est pas un terrain vague ou une absence de courage : il est un point de convergence pour les convictions humanistes, un espace de dialogue incessant. Nous croyons à la liberté, à cette possibilité d'infléchir le futur, personnellement ou ensemble, au plus près des réalités. Nous savons que l'efficacité économique peut se conjuguer avec l'équité sociale.
Le philosophe Etienne Borne disait : "On ne donnera un sens à l'action qu'en donnant d'abord et prioritairement un sens à la vie". La politique retrouvera sa cohérence lorsqu'elle sera expérimentée. Seul compte le témoignage : le Français croit aux paroles quand il constate qu'elles sont vécues.
Il est urgent de réagir et d'inventer un centre renouvelé et élargi en unissant les énergies : "C'est l'espace de la géographie politique où la cassure serait mortelle" écrivait encore Etienne Borne. Les trop nombreuses structures, les partis et groupes parlementaires pourraient apprendre à communiquer, à débattre pour construire des consensus, des majorités d'idées voire un projet politique concret, un programme ayant du sens qui traduirait des valeurs humanistes et républicaines.
Car avant les stratégies partisanes et les plans de carrière doivent se révéler le bien commun et l'intérêt général. Trop souvent et presque toujours, les déclarations et des uns et des autres masquent et mal les dévorantes ambitions personnelles et présidentielles...
Rêvons encore que Jean-Luc Mélenchon entende ce que son ami Jean d'Ormesson proposait en 2010 : "Dépassons ce qui nous oppose et multiplions ce qui nous unit".
J'en appelle à l'humilité contre les égos, à la vérité contre la 'com', à la fraternité contre l'affrontement, à la mesure contre les excès. Un dialogue ouvert peut mettre d'accord 70 % de nos concitoyens, en dehors des extrêmes des deux bords.
Cette crise de la représentation qui asphyxie le débat démocratique résulte aussi de la crise de l'engagement qui atteint la société française : les partis, les syndicats, les associations manquent de militants et de bénévoles, de désintéressement. Que fais-tu pour ton quartier, pour ton pays ? Que puis-je changer dans mon quotidien ? Les réponses appartiennent à chacune et chacun. Ce sont les attitudes et les actes concrets qui contribueront à apporter aux générations nouvelles des raisons d'espérer.
Ce n'est pas dans les urnes ou dans la rue que se joue le destin de la personne mais c'est d'abord en chacun de nous proclamait Emmanuel Mounier.
Et ce sera plus facile quand l'exemple viendra d'en haut...
Monsieur le Président, la République n'en serait pas moins grande si elle était plus modeste. Croyez dans l'efficience de l'humilité.
Puis-je vous proposer un petit conseil ? Retrouvez sur le site de l'INA la conférence de presse de Georges Pompidou le 22 septembre 1969. Le Président répond à un journaliste qui l'interroge sur l'affaire Russier. Tout est là.
Pierre Kerlévéo
Vie de l'Amicale
Merci Bruno
Mardi 29 octobre, nous apprenons avec une grande émotion le décès de notre ami Bruno Coiraton que nos adhérents connaissaient depuis longtemps. Il était le trésorier de notre Amicale. C'était son domaine : les adhésions, la comptabilité, la banque, les impôts, le patrimoine, les relations avec le MoDem, notre voisin de copropriété et d'idéal commun.
Bruno va beaucoup nous manquer. Dans un prochain bulletin, ses amis évoqueront sa mémoire et rappelleront des souvenirs communs du militant MRP qu'il a été depuis sa jeunesse.
Ayant subi une opération délicate le 24 septembre dernier, il a connu des complications graves par la suite, qui l'ont emporté le 29 octobre. Il rejoint son épouse bien aimée, décédée subitement le 26 novembre 2023.
A sa fille, à son frère et à tous ses proches, l'Amicale du MRP adresse ses condoléances, partage leur grande peine et s'unit à leurs prières.
Anne-Marie Catherin
Mort de Jean Chélini
Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de Jean Chélini le 24 septembre dernier, à Aix-en-Provence. Il avait 93 ans. Professeur émérite de l'Université d'Aix-Marseille, il était aussi secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille, sa ville natale.
Historien médiéviste, il avait été l'élève de Pierre Riché et l'assistant de Georges Duby avant de suivre sa propre voie.
Connu comme un des pionniers et un des meilleurs spécialistes universitaires de l'histoire religieuse, il s'intéressait non seulement à l'Eglise du Moyen Age - son Histoire religieuse de l'Occident médiéval est devenu un grand classique - mais aussi à l'histoire récente du Vatican et de la papauté auxquels il consacra de nombreux ouvrages. Cet intérêt pour l'histoire du catholicisme au XXe siècle l'avait amené à suivre, pour la presse, les travaux du concile Vatican II. Fidèle à ses origines méditerranéennes, il fut aussi un chroniqueur régulier de la presse régionale. Adjoint centriste de Jean Claude Gaudin à la mairie de Marseille pendant plusieurs années, Jean Chélini a été un ami très fidèle de l'Amicale du MRP. Nous adressons nos condoléances attristées à son épouse et à ses quatre enfants.
Réunion de rentrée
La réunion de rentrée du bureau de l'Amicale s'est tenue le mardi 24 septembre. Présidée par Pierre
Méhaignerie, en présence de Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur du Pas-de-Calais, elle accueillait Christophe Bellon, professeur d'histoire contemporaine à l'Université catholique de Lille, animateur du Centre d'histoire parlementaire et politique de Sciences Po et auteur avec Jacques Barrot de De l'indignation à l'engagement, foi et politique (collection L'Histoire à vif, Etions du Cerf, mars 2012).
Il venait nous informer et faire le point sur l'organisation des deux manifestations en préparation pour commémorer, d'une part le dixième anniversaire de la disparition de Jacques Barrot, d'autre part le centenaire de la création du Parti démocrate populaire.
Dix ans déjà... Le 3 décembre 2014, notre ami Jacques Barrot nous quittait, frappé par une crise cardiaque sur le chemin qui le menait au Conseil constitutionnel. La journée d'études qui lui sera consacrée se déroulera le 6 décembre prochain, à l'Assemblée nationale. Les trois volets de son engagement politique, local, national et européen, seront évoqués.
Comme il était difficile, notamment pour des raisons de disponibilité des intervenants, d'organiser une seconde manifestation dans un délai trop rapproché, il a été décidé de reporter le colloque consacré à la Démocratie chrétienne au premier semestre 2025, en référence au premier Conseil National du PDP réuni à la fin de juin 1925. Ce colloque dont le programme n'est pas encore totalement arrêté, pourrait se dérouler sur une journée : la première partie serait consacrée à 'l'histoire' de ce courant politique (les sources, les fondateurs, les penseurs, les premiers mouvements et partis...) ; les intervenants seraient surtout des historiens ; la seconde analyserait 'l'action', notamment celle du MRP (questions sociales, politique familiale, Europe, syndicalisme, cf. JAC, Semaines sociales, etc.) ; les intervenants seraient à la fois des historiens mais aussi des témoins, des politiques ; la troisième ouvrirait sur 'l'avenir'.
A la suite de l'exposé de Christophe Bellon, Pierre Méhaignerie et Jean Marie Vanlerenberghe, ont plaidé pour que ces manifestations ne soient pas uniquement tournées vers le passé mais soient l'occasion d'une réflexion à la fois sur l'actualité des valeurs portées par la démocratie chrétienne et le centre, mais aussi sur la pertinence de la démarche à privilégier (expérience du terrain, solutions concrètes, pragmatisme, responsabilité). Pierre Kerlévéo a notamment insisté sur l'importance de la recherche de consensus, de la culture du compromis (cf. Laurent Berger, Jean Viard, Pour une société du compromis, L'aube, avril 2024).
Pierre Méhaignerie, approuvé par tous, souhaiterait que ces journées puissent aussi être l'occasion de retrouvailles entre les différents courants se réclamant de la démocratie chrétienne et du centre, aujourd'hui dispersés.
Le point sur... la bibliothèque centriste et les archives de la revue France Forum
En début d'année, le bureau de l'Amicale avait accepté de mettre à disposition une partie de ses locaux du 133 bis rue de l'Université pour accueillir une 'bibliothèque du centrisme' où l'on pourrait trouver des revues et des ouvrages de référence sur la démocratie chrétienne, ses sources, ses fondateurs, le MRP et ses héritiers, la construction européenne, etc. ainsi que les archives et une collection complète de la revue France Forum. Un contrat formel entre l'Amicale du MRP, d'une part, et l'Union française/France Forum, d'autre part, a été signé afin de préciser les modalités de cette collaboration, sachant que l'Amicale conservera le contrôle absolu sur ses locaux.
Le déménagement, au début du mois de juillet 2024, du siège de l'Institut Jean Lecanuet et ancien siège de l'Union française/France Forum, situés au 31, rue de Poissy, à Paris, a été l'occasion de faire avancer le projet.
Ont ainsi été triés puis rapatriés et stockés pour le moment dans les bureaux de l'Amicale :
- Les archives et documents concernant France Forum :
archives administratives et comptables de l'Union française, bulletins des clubs France
Forum, comptes rendus des comités de rédaction, photographies, archives diverses (années 1950 à 1970), un certain nombre de numéros de la revue Démocratie moderne, une collection complète de la revue France Forum.
- Des ouvrages sur la démocratie chrétienne, le centre et l'Europe :
l'Institut Jean Lecanuet a offert gracieusement un certain nombre d'ouvrages, environ 150, à la future bibliothèque centriste (ouvrages de référence, biographies, ְécrits de personnalités, etc.). L'Institut nous a également cédé gracieusement un meuble bibliothèque-vitré et deux armoires de rangement.
Cet important travail de tri et de sélection, a été effectué par la nouvelle équipe de France Forum - qui s'est aussi chargée du déménagement -, en collaboration avec des membres de l'Amicale et de l'Institut Jean Lecanuet, que nous remercions vivement pour son aide et ses apports ; un merci tout particulier à Catherine Bruno, secrétaire générale de l'Institut.
Il s'agit maintenant pour nous de mettre de l'ordre dans toute cette documentation afin de pouvoir la rendre accessible. Appel est lancé à toutes les bonnes volontés.
Actualité de la pensée démocrate-chrétienne (2)
En lien avec la journée d'études à venir consacrée à Jacques Barrot, nous avions reproduit dans le précédent Bulletin de l'Amicale la première partie du beau texte co-écrit par Jacques Barrot et François Bayrou en octobre 1990, à l'occasion de la Convention de Saint-Malo du CDS, et intitulé 'Actualité de la pensée démocrate-chrétienne'. Ils y réaffirmaient les fondements de l'action de notre famille politique, les sources dont elle s'inspirait et les valeurs qu'elle défendait. La seconde partie développe la manière de les mettre en oeuvre.
Certes, le contexte n'est plus le même. Depuis trente ans le monde a profondément changé tant sur le plan des modes de vie, des avancées technologiques - Internet a supplanté et remplacé le Minitel, les réseaux sociaux ont modifié notre manière de communiquer - que sur celui des relations interétatiques et des enjeux de puissance. La disparition de l'Union soviétique a déstabilisé le continent européen, la guerre a fait son retour à nos frontières, dès 1991 en Yougoslavie, aujourd'hui en Ukraine.
Pourtant, au-delà des formulations ou des références datées, bien des pistes d'action proposées restent d'actualité qu'il s'agisse de responsabilité, de représentativité et de vie démocratique, de l'attention à porter aux plus faibles, enfants et vieillards - un terme que l'on n'utilise plus aujourd'hui -, des difficultés du monde agricole, de l'industrialisation du pays mais aussi de l'accueil des migrants ou de la préservation du patrimoine naturel à l'intention des générations futures... A bien des égards ce texte a des accents prémonitoires. Des projets et des actes
1. Le renouveau de la démocratie politique et sociale
Le partage des responsabilités
L'épanouissement des personnes ne peut se faire que dans une société très largement décentralisée, animée par le principe de subsidiarité qui fait qu'on accorde le maximum de compétences, de pouvoir, aux personnes et aux groupes qui peuvent les exercer, sans réclamer l'intervention des supérieurs dans la hiérarchie du pouvoir.
Cela doit se traduire par un grand effort de démocratisation sur le plan local, en portant une grande attention au processus démocratique, à la qualité des débats quotidiens, au partage des fonctions, au refus d'un exercice trop personnalisé du pouvoir.
En outre, à l'heure des média, il faut s'interroger sur les moyens de préserver une représentativité fiable de ces communautés de base aux différents échelons de la vie démocratique.
Le renouveau associatif
A cette démocratie politique doit correspondre une démocratie sociale plus exigeante avec, au sein de l'entreprise, la mise en oeuvre de la co-responsabilité des acteurs socio-économiques, de la participation et avec, au coeur de la vie sociale, un renouveau associatif.
Le militantisme social est indispensable pour la prévention des grandes exclusions, que ce soient l'illettrisme, la solitude ou toutes les inadaptations professionnelles.
Les Démocrates-Chrétiens ne peuvent pas se désintéresser du renouveau indispensable du syndicalisme et du mutualisme : toutes ces formes de solidarité organisées sont les seules capables de mettre la société à l'abri de toutes les formes de violence sociale : violence contre les marginaux, à l'égard des plus âgés, des plus faibles...
Une démocratie éthique plus respectueuse des personnes, plus exigeante, plus juste
Cette dimension s'impose d'autant plus que nos sociétés connaissent une lente dérive vers une permissivité culturelle et un matérialisme hédoniste.
Qu'il s'agisse de l'enfant ou du vieillard, seul un Etat de droit rigoureux peut préserver leur autonomie et les assurer du respect et de l'attention dont ils ont besoin.
Cette démocratie éthique a besoin d'une justice, d'un pouvoir judiciaire fort et respecté. Elle a besoin aussi d'instances de régulation. De la Commission Informatique et Liberté au Conseil Supérieur de l'audiovisuel, cette société a besoin d'autorités régulatrices assurées de voir leur indépendance respectée et leurs recommandations suivies d'effets.
2. La régulation de la vie économique
Les faits démontrent que l'économie de marché crée les meilleures conditions pour la croissance, la création d'emplois et l'élévation du niveau de vie.
Encore faut-il que les conditions d'un véritable marché soient réunies en dépit des entraves multiples et sans cesse renaissantes, ce qui suppose la liberté de l'information économique (publicité comparative), la vigilance de consommateurs actifs, l'intervention de la puissance publique, au niveau adéquat pour faire respecter les règles du jeu et le pluralisme des intervenants.
La libre entreprise est un facteur indispensable de la créativité économique. Elle suppose non seulement la liberté formelle, mais aussi que soient remplies les conditions de cette liberté, en particulier l'égalité des chances, la limitation des charges aux obligations propres de l'entreprise, la neutralité de l'Etat qui ne doit pas, sous couvert d'assumer ses responsabilités générales, incontestables pour la régulation de l'économie, utiliser les moyens dont il dispose à des fins qui ne correspondent pas à ces responsabilités.
En elle-même, cependant, l'économie de marché et la libre entreprise ne sauraient garantir ni le plein emploi ni la performance universelle du système de production, comme en témoignent la persistance du chômage, les difficultés du monde agricole et les lacunes du système de production spontanée par exemple dans le domaine des équipements (de la machine-outil à l'aérospatiale), voire même les biens de consommation courante (photo, vidéo, etc.).
Il convient donc de rechercher les voies et les moyens qui permettent de compenser ces carences, ce qui suppose l'intervention de la puissance publique dont il serait irréaliste de nier systématiquement la responsabilité et une efficacité dont témoignent, non sans éclat, l'industrie nucléaire, Airbus, le Minitel, le TGV ou la fusée Ariane.
La prospérité
Rien n'est plus efficace que l'économie de marché pour assurer la croissance et la réussite professionnelle du plus grand nombre.
Encore faut-il établir la distinction entre croissance et développement - six pour cent de croissance au Brésil n'assurent pas nécessairement le développement optimal et introduisent dans la société des lignes de fracture préjudiciables à une prospérité de long terme.
Plus encore, l'économie de marché peut se trouver entravée par une spéculation financière qui préfère les opérations spéculatives d'achat et de revente des actifs mobiliers à la recherche de la création de richesses. Une certaine économie financière, lorsqu'elle se dissocie de l'économie tout court, peut, d'une certaine manière, jouer contre la prospérité.
L'égalité des chances
L'égalité dignité des hommes veut que la prospérité soit partagée et exige pour cela une égalité des chances qui ne se confonde pas avec une assistance généralisée peu respectueuse des personnes.
L'égalité des chances implique d'abord une solidarité générale devant les grands risques de l'existence : la maladie, la vieillesse, l'accident. Les régimes de sécurité sociale peuvent être infléchis vers une plus grande responsabilisation, ils doivent revêtir une efficacité accrue quand il s'agit de ceux qui sont les plus douloureusement atteints.
Mais, notre idéal social va aujourd'hui plus loin que la garantie contre les grands risques ; il implique, de manière positive, un accès aux chances de la vie. Il ne s'agit plus d'en rester à un certain partage de l'avoir, il faut veiller à un véritable partage du savoir.
La lutte contre l'illettrisme devrait être une des clés de la politique démocrate-chrétienne appliquant ainsi l'idéal de Marc SANGNIER qui voulait que chacun puisse aller vers son épanouissement optimum.
L'accès à la culture est aussi fondamental : l'Etat doit l'ouvrir à tous en utilisant son autorité sur les grands moyens de communication, en engageant les moyens financiers nécessaires au niveau de la création culturelle.
La réussite de la communauté
Le marché est un élément efficace pour stimuler les énergies et permettre la prospérité de la société avec un échange optimal des biens ; il n'est pas capable, à lui seul, de dégager les équilibres qui permettront de réussir ensemble l'avenir de la communauté.
C'est pourquoi l'Etat garde une mission régulatrice. Il doit être là pour éviter une urbanisation sauvage, fruit exclusif d'intérêts immédiats et donc anarchiques. Il doit être là pour instituer des normes, une éthique en vue de préserver le patrimoine naturel à l'intention des générations futures.
A cet égard, la pensée chrétienne peut fournir à l'écologie une référence philosophique et éthique que ne suffisent pas à lui donner des considérations trop ponctuelles ou une simple recherche de confort individuel. L'épanouissement de l'homme ne peut pas se faire sans la communauté et une communauté réussie. Un Etat moderne ne peut pas prétendre faire le bonheur de ses citoyens :il laisse jouer les acteurs économiques et sociaux, mais il doit leur rappeler l'ambition d'une réussite collective. Il doit veiller dans cette recherche à la cohésion sociale.
Ni l'extrême-droite qui, sous prétexte de réaliser la cohésion, mutile et exclut l'autre, ni l'extrêmegauche qui prétend qu'une partie du peuple détient le monopole de la générosité à l'encontre de l'autre, ne peuvent prétendre parvenir à cette cohésion sociale.
Ainsi, la pensée démocrate-chrétienne va au-delà des recettes sociales-démocrates : en affirmant une supériorité de 'l'Etre sur l'Avoir', elle ne réduit pas la politique sociale à un simple exercice de redistribution des richesses, à un simple partage de l'Avoir.
3. Le dépassement des nationalismes
La pensée démocrate-chrétienne adhère pleinement à l'idéal fédéraliste dont le banc d'essai le plus significatif est aujourd'hui manifestement la Communauté européenne : nouveau type de communauté de peuples qui ont accepté d'exercer, ensemble, certains attributs de la souveraineté.
Face au double échec du nationalisme autarcique et de l'internationalisme invertébré, un grand mouvement de pensée transnational favorise la recherche d'un nouvel ordre international qui permet de dépasser le heurt des Etats-Nations et le mépris des minorités.
Le Fédéralisme permet au pouvoir politique démocratique de ne pas baisser les bras devant une économie internationale. A une économie qui ne se limite plus aux frontières doit correspondre un pouvoir de régulation lui-même supranational. La construction d'une Europe communautaire plus qu'inter-gouvernementale est, à cet égard, un impératif absolu pour les Démocrates-Chrétiens.
4. La coopération et le partage internationaux
La conception chrétienne de l'homme nous renvoie à son caractère fraternel et universel. Qui dit universalité dit partage à l'échelon de la planète. Les Démocrates-Chrétiens doivent être des pionniers en matière d'échanges entre pays riches et pays pauvres avec la volonté de refuser toute forme d'assistanat, en privilégiant le partenariat, en engageant des actions de solidarité qui, loin d'atténuer les responsabilités des peuples sous-développés, leur restituent la capacité d'exercer ces responsabilités.
Les accords de Lomé, largement inspirés par les Démocrates-Chrétiens, se sont inscrits dans cette ligne ; aujourd'hui il s'agit de gérer la dette des pays du Tiers-Monde, il s'agit d'apporter une aide urgente à l'Afrique, à charge pour les Africains d'accepter l'Etat de droit, les règles démocratiques, pour permettre aux aides reçues de fructifier.
Mais cette exigence de fraternité universelle veut aussi que nos pays développés ne se laissent pas dominer par la peur de l'Etranger, de 'l'Autre, et affrontent les défis concrets qu'implique la présence des immigrés au milieu de nous. A cet égard, il faut le rappeler, la négation ou le mépris de l'étranger se paient un jour ou l'autre au prix fort.
La fin du XXe siècle risque d'être marquée par un fort courant individualiste dans nos sociétés occidentales où les citoyens auront tendance à déserter le débat politique, à refuser les responsabilités, difficiles à assumer dans une société complexe.
Dans ce climat, il est à craindre que les coalitions politiques manquent de souffle : le socialisme justifiait la croisade libérale pour l'économie de marché, son effondrement laisse ce même libéralisme orphelin de grandes ambitions. C'est alors que les sociétés politiques, pour se donner le change, risquent de flatter les nationalismes.
Face à ces dangers, les Démocrates-Chrétiens doivent s'arc-bouter pour maintenir dans nos pays le sentiment d'une appartenance à une communauté de destin et d'espérance au travers de projets pour une société où prévalent une meilleure égalité des chances et une meilleure qualité d'existence pour chacun.
Les Démocrates-Chrétiens, souvent membres de coalitions constituées avec les libéraux, ont, à cet égard, un rôle déterminant à jouer. Fils d'une Eglise 'experte en Humanité', selon Paul VI, nous pouvons assurer un rayonnement sans chercher à taire nos sources ou à les imposer.
Nous devons aussi appeler nos différentes communautés nationales à se dépasser vers une communauté des peuples de l'Europe. En son sein, se développeront de multiples échanges et se fortifiera une conception exigeante et élevée de la personne humaine.
Les autres peuples du monde attendent beaucoup de cette vieille Europe dont le génie humaniste, éclairé par la foi, a créé cette conception de l'homme marquée à la fois par la transcendance et l'universalité. C'est dire le rôle majeur que devrait jouer dans les années qui viennent la Démocratie Chrétienne.
Centenaire du PDP : l'exposition Du sillon aux étoiles
Lors du Congrès du Mouvement Démocrate, qui se tenait les 23 et 24 mars 2024 à Blois, les militants, les intervenants et les élus étaient invités, avant de rejoindre la salle plénière où se déroulaient les débats, à visiter l'exposition organisée pour commémorer le centenaire de la fondation du Parti Démocrate Populaire (PDP) en 1924. C'est l'histoire de notre famille politique, des précurseurs à nos jours, que font découvrir aux plus jeunes, ou revivre aux plus anciens, les quelques 300 documents originaux patiemment collectés et rassemblés par Fabien Robert, Secrétaire général adjoint du MoDem, directeur de l'Institut de formation des élus démocrates.
Affiches, tracts, écrits et objets exposés dans les vitrines racontent, au fil d'un parcours chronologique, un siècle de combats au centre de l'échiquier politique pour que vive la démocratie.
Une histoire de filiation dont témoigne le titre évocateur de l'exposition, du sillon aux étoiles, en référence à La Charrue et l'étoile, livre d'André Diligent, dont le père, Victor Diligent, ami de Marc Sangnier, était un membre éminent du PDP. Un retour vers le passé mais aussi une ouverture sur l'avenir que symbolisent les étoiles de la bannière européenne.
L'exposition a également été présentée lors de l'Université de rentrée du MoDem à Guidel.
Parcourons-la en s'appuyant sur quelques photographies prises par des membres de l'Amicale.
Les précurseurs
Les premières vitrines évoquent les origines du mouvement démocrate-chrétien en
France, les racines du catholicisme social autour de personnalités emblématiques : Charles de Montalembert et Félicité de
Lamennais qui fondent en 1830 le quotidien L'Avenir réconciliant catholicisme et démocratie, 'Dieu et la Liberté' ;
Lacordaire et Frédéric Ozanam qui lancent, après la Révolution de 1848, L'Ere nouvelle. Sans oublier, au tournant du XXe siècle, l'abbé Lemire et les abbés démocrates, ni
Albert de Mun. Le premier, prêtre, maire et député, à l'origine des Jardins ouvriers, aspirait à réconcilier l'Eglise et les classes populaires. Le second, un des fondateurs de l'Action Libérale Populaire, parti non confessionnel, tentait de rallier les catholiques à la République dans un contexte difficile où l'anticléricalisme restait vivace dans les allées du pouvoir. Autant de figures lumineuses qui ont ouvert le chemin.
Marc Sangnier, du Sillon à la Jeune République
L'encyclique Rerum Novarum, publiée en 1891 par le pape Léon XIII, encourageait le catholicisme social. Autour du journal Le Sillon, fondé l'année suivante par Paul Renaudin et dirigé par Marc Sangnier, se crée un mouvement original, ouvert sur le monde ouvrier. En 1909, Sangnier lance un quotidien, La Démocratie. Mais la ligne du Sillon, laïque, favorable à la Séparation des Eglises et de l'Etat et au dialogue interconfessionnel, est désavouée par le pape Pie X et l'épiscopat. En 1912, Sangnier fonde la Ligue de la Jeune République, un mouvement politique très en avance sur le plan social, en faveur du vote des femmes, pacifiste et anticolonialiste, imprégné de la doctrine personnaliste d'Emmanuel Mounier qui replace la personne humaine au centre de l'action politique.
1924, création du PDP
Fondé lors du congrès de Paris des 15 et 16 novembre 1924, le Parti Démocrate Populaire est le premier 'parti démocrate d'inspiration chrétienne' d'envergure en France. Le nombre de ses militants, 6 000 en 1924, atteint son maximum, autour de 20 000, en 1934. Dans le contexte de l'immédiat après-guerre, le parti prône la réconciliation entre les peuples et veut rassembler les différentes composantes de la démocratie chrétienne ; il se positionne plutôt au centre-droit. Les idées du PDP se propagent dans les milieux catholiques via le quotidien L'Aube, lancé en janvier 1932 par Francisque Gay. On trouve parmi les signatures, le philosophe Etienne Borne, l'écrivain Julien Benda, mais aussi Robert Schuman, Louis Terrenoire, Georges Bidault qui devient rédacteur en chef en 1934.
De la Résistance au MRP
Les vitrines suivantes font une large place à la naissance dans la clandestinité puis à l'action du
Mouvement Républicain Populaire (MRP), grande force politique de la IVe République.
Du manifeste de Gilbert Dru, membre de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), résistant exécuté par la Gestapo, à Lyon, le 27 juillet 1944, à l'âge de 24 ans, un de 'ceux qui croyaient au ciel', jusqu'aux nombreuses affiches et publications parmi lesquelles l'hebdomadaire Forces Nouvelles, nous parcourons toute l'histoire du mouvement, de son apogée - il obtient 28 % des voix aux élections de juin 1946 et devient le premier parti de France, devançant le parti communiste -, à son déclin progressif après 1958.
'Parti nouveau animé par des résistants courageux', le MRP entre en scène à la Libération. Force politique centrale du nouveau régime, le parti comptera dans ses rangs trois présidents du Conseil :
Robert Schuman, Georges Bidault et Pierre Pflimlin. Défenseur de 'la démocratie, l'Europe, la justice sociale', il joue un rôle majeur dans le redressement et la reconstruction du pays.
Devenues 'citoyennes à part entière' depuis août 1944, les femmes du MRP, au travers des 'équipes féminines', sont à l'initiative d'avancées importantes en matière de politique sociale et familiale. Mais le MRP est surtout l'ardent apôtre d'une Europe unie. Après avoir soutenu le retour au pouvoir du général De Gaulle en 1958, c'est d'ailleurs à la suite d'un désaccord sur leur vision de l'Europe qu'en 1962 il quitte le gouvernement et entre dans l'opposition.
Mais arrêtons-nous un instant sur son programme originel tel qu'il apparaît sur une des affiches exposées. Nous sommes en 1946. Après le départ du général De Gaulle en janvier, il s'agit de faire adopter une nouvelle Constitution. Un premier projet est rejeté par référendum le 5 mai et, à la suite de nouvelles élections qui confirment le succès du MRP, un second projet est soumis au vote des Français en octobre. Le MRP fait campagne pour l'adoption. On remarque la forte orientation sociale de son projet, son désir d'installer une paix durable et une démocratie authentique.
Le Mouvement Républicain Populaire M.R.P.
Parti de la 4e République
Parti nouveau animé par des résistants courageux
Pour la libération totale du Peuple de France
Veut construire une REPUBLIQUE,
indépendante, jeune, forte et juste.
IL EXIGE :
- Une organisation internationale de la paix assurant la sécurité définitive de la France
- La libération totale de l'Etat des trusts et des puissances d'argent
- Une réforme administrative profonde qui libère les Français de la paperasserie envahissante et de l'oppression bureaucratique
- Une politique familiale audacieuse reconnaissant pour tous le droit à une vie heureuse et libre
- Une politique hardie de reconstruction, de rééquipement et de modernisation tant à la campagne qu'à la ville et sur le plan industriel
- La participation des travailleurs au profit et à la gestion des entreprises, l'accession de tous à la propriété
- Le renforcement des organisations professionnelles, paysannes et ouvrières, la généralisation des organismes corporatifs
- Un système scolaire assurant aux jeunes de toutes les classes sociales un véritable droit à l'instruction, respectant à la fois la liberté de l'enseignement et la neutralité de l'Etat
- La protection et le développement des exploitations rurales familiales.
Il veut une Constitution Nouvelle
Garantissant le droit au travail, le respect de la personne humaine, et toutes les libertés essentielles des citoyens et de leurs familles
Permettant un fonctionnement rapide et efficace de l'appareil gouvernemental.
POUR ASSURER sa VICTOIRE et CELLE de ses IDEES
Vous voterez M.R.P. Vous répondrez OUI et OUI
AUX DEUX QUESTIONS DU REFERENDUM
Jean Lecanuet et le centrisme
Changement d'époque. En 1965, en obtenant 16 % des suffrages à la première élection au suffrage universel de la Ve République, Jean Lecanuet redonne vie au MRP alors en perte de vitesse. L'année suivante, entraînant dans son sillage nombre de membres du mouvement, rejoints par des modérés et des radicaux, il crée un nouveau parti, le Centre démocrate qui obtient 12 % des voix aux élections législatives de 1967.
Il s'agit de promouvoir une 'démocratie moderne', titre choisi pour le journal du parti qui se situe d'emblée sur le terrain des valeurs. Cependant des voix discordantes se font entendre dès le référendum de 1969 sur la création de régions et la rénovation du Sénat. La majorité du parti défend le Non, qui l'emporte, et se range derrière la candidature d'Alain Poher, président du Sénat, résistant et membre du MRP, à l'élection présidentielle qui suit la démission du général De Gaulle. Mais un certain nombre de dirigeants centristes, autour de Jacques Duhamel, Joseph Fontanet et René
Pléven, ont soutenu Georges Pompidou. Ils fondent le Centre Démocratie et Progrès (CDP).
Lors de l'élection présidentielle de 1974, l'ensemble des formations centristes se rallie à la candidature de Valéry Giscard d'Estaing. Au congrès de Rennes, des 21-23 mai 1976, le Centre démocrate et le CDP se retrouvent et fusionnent au sein du Centre des Démocrates Sociaux (CDS). L'unité est refaite.
Jean Lecanuet est élu président, Jacques Barrot, secrétaire général. Ils entreprennent ensemble un 'tour de France' pour présenter à la presse régionale la nouvelle formation.
En 1977, André Diligent remplace Jacques Barrot au secrétariat général du parti. En octobre, au congrès de Lyon, il présente le 'petit livre bleu', intitulé L'Autre Solution qui réaffirme les valeurs sur lesquelles repose l'engagement au centre. Jean Lecanuet reste à sa tête du CDS jusqu'au congrès de Versailles de 1982 où Pierre Méhaignerie lui succède.
En 1978, le CDS rejoint l'Union pour la Démocratie Française (UDF), fédération créée en vue des élections législatives et regroupant les différentes composantes centristes, modérées et giscardiennes de la majorité présidentielle. Jean Lecanuet est son premier président, fonction qu'il conserve jusqu'en 1988.
Ce compagnonnage avec des mouvements plus libéraux et l'alliance à droite, plus ou moins conflictuelle, avec les héritiers du gaullisme influent sur la ligne originelle du parti qui, en 1988, soutient la campagne présidentielle de Raymond Barre.
Lors des élections européennes de juin 1989, alors qu'une liste d'union UDF/RPR se constitue derrière Valéry Giscard d'Estaing, le CDS présente une liste indépendante, 'Le Centre pour l'Europe', menée par Simone Veil qui n'arrivera malheureusement qu'en 5e position avec 8,43 % des suffrages. Les Jeunes Démocrates Sociaux (JDS), se sont impliqués fortement dans la campagne notamment par voie d'affiches. Le mouvement de jeunesse du parti, très actif, organise des rencontres, des concerts - on se souvient du fameux Eurofestival de 1979 -, et surtout, chaque année, les Universités d'été qui regroupent, dans un cadre décontracté et amical, dirigeants et militants. Les JDS furent une pépinière de futurs élus et cadres du mouvement.
De leur côté, les Républicains indépendants, autour de Valéry Giscard d'Estaing, ont lancé, en 1966, leur propre mouvement de jeunes, les Jeunes républicains indépendants (JRI). En 1974, après l'élection à la présidence de leur candidat, qui souhaitait donner une image de modernité et de renouvellement générationnel, il devient Génération sociale et libérale. C'est en son sein que Marielle de Sarnez fera ses classes en politique.
François Bayrou, l'héritier
L'exposition, dans sa dernière partie, fait le lien avec le présent. Elle consacre François Bayrou et son parti comme héritiers et continuateurs de cette longue histoire. Depuis son élection en 1994 à la présidence du CDS, devenu en 1995 Force démocrate, jusqu'à la fondation en 2007 du Mouvement Démocrate (MoDem), il a su faire entendre une voix singulière. En témoignent son vote, à titre personnel, pour François Hollande à la présidentielle de 2012, ou son soutien, mais conditionnel, au projet de dépassement du clivage droite/gauche porté par Emmanuel Macron.
2002, date charnière. Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle avec près de 18 % des voix. Jacques Chirac est élu au second tour avec 82 % et, face à la montée de l'extrême-droite, il propose avec Alain Juppé de rassembler en un seul grand parti la droite et le centre. Ce sera l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP), que rejoignent alors de nombreux dirigeants centristes de l'UDF.
François Bayrou, et d'autres, préfèrent conserver une ligne indépendante. En 2002, il était arrivé quatrième à l'élection présidentielle avec un faible score, un peu plus de 6 % des voix, mais en 2007, il se place en troisième position avec plus de 18 % des suffrages. Dans la foulée, il annonce la création d'un grand parti démocrate. Après avoir acté la disparition de l'UDF, il proclame en décembre devant les militants réunis à Villepinte, la naissance du MoDem, un parti ouvert à des personnalités venues d'autres bords, la gauche, l'écologie, la société civile. Mais tous les centristes de l'UDF ne se reconnaissent pas dans cette nouvelle offre politique. On les retrouve aujourd'hui au sein de l'UDI et du Nouveau Centre/Les Centristes.
En attendant les colloques de la fin de l'année et du début de l'année prochaine, cette riche exposition propose une démarche mémorielle bienvenue. Mais l'Histoire se poursuit. Nombreux sont ceux qui aspirent à la fin de l'éparpillement de la famille centriste. Dignité de la personne humaine, Europe, famille, progrès social, démocratie véritable, les valeurs auxquelles nous croyons méritent plus que jamais d'être défendues.
Béatrice Kalaydjian
Amicale du Mouvement Républicain Populaire
(MRP - 1944 / 1967)
L'Amicale du MRP a été créée en 1980 :
- pour rassembler ceux qui avaient été les acteurs de cette famille politique issue de la Résistance, élus et militants, et ceux qui, après 1967, ont rejoint leurs héritiers, au sein
de cette mouvance démocrate chrétienne située au centre de l'échiquier politique ;
- pour faire connaître l'histoire du MRP et faire sortir de l'oubli les noms de ses fondateurs, de ces hommes et ces femmes, ministres, parlementaires, élus locaux qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont participé activement au relèvement de la France (site historique de l'Amicale : www.amicalemrp.org) ; - pour maintenir et promouvoir les valeurs qui les animaient et qu'ils défendaient par leur engagement et leur action.
Aujourd'hui, nous poursuivons nos objectifs et souhaitons rassembler toutes celles et ceux qui, dispersés au sein de divers partis, mouvements, associations, restent profondément attachés à ces valeurs et veulent qu'elles perdurent dans la vie politique.
Pierre MEHAIGNERIE Anne-Marie CATHERIN Bruno COIRATON
Président Secrétaire générale Trésorier
BULLETIN D'ADHESION 2025
- Abonnement, cotisation et contributions aux publications 35 euros
- Cotisation de soutien 50 euros
- Don complémentaire :
- Vos nom et prénom :
- Votre adresse :
- Votre téléphone :
- Adresse Mail :
Rédiger votre chèque à l'ordre de : Amicale du MRP - 133 bis rue de l'Université, 75007 Paris
- Montant du chèque :
- Date de votre envoi :
Merci, avec vous l'Amicale sera plus efficace !
SOMMAIRE
Le mot du Président :
'Concilier efficacité économique et justice sociale' par Pierre Méhaignerie : p. 1-2
Un nouveau gouvernement : p. 2-3
Point de vue :
'Lettre à mon Président' par Pierre Kerlévéo : p. 4-5
Vie de l'Amicale :
• Merci Bruno, hommage à Bruno Coiraton par Anne-Marie Catherin : p. 5
• Mort de Jean Chélini : p. 6
• Réunion de rentrée : p. 6-7
• Le point sur... la Bibliothèque centriste : p. 7
Actualité de la pensée démocrate-chrétienne (2) : par Jacques Barrot et François Bayrou,
Convention de Saint-Malo du CDS, octobre 1990 : p. 8-12
Centenaire du Parti Démocrate Populaire :
l'exposition 'Du sillon aux étoiles' : par Béatrice Kalaydjian, p. 12-20
Cotisation 2025 : p-21
L'Amicale du MRP
133 bis rue de l'Université 75007 PARIS
Site : www.amicalemrp.org
Directeur de la Publication Pierre Méhaignerie
|
|
|
|
|
|

|
|
|
ARCHIVES MODE EMPLOI
ARCHIVES AG
ASSEMBLEES GENERALES
|
|
|
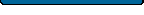
|
|
|

|
|
|
|
|
|
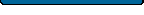
|
|
|
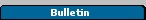
|
|
|
N° 1 du 1er trim. 1982
|
|
|
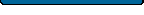
|
|
|

|
|
|
Une permanence est assurée par les membres de l'amicale du M.R.P. les :
- Jeudis de 11h00 à 17h00
A noter
-nouvel e-mail de l'Amicale:
amicalemrp@laposte.net
-N°téléphone 01 53 59 20 00
|
|
|
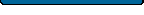
|
|
|
|