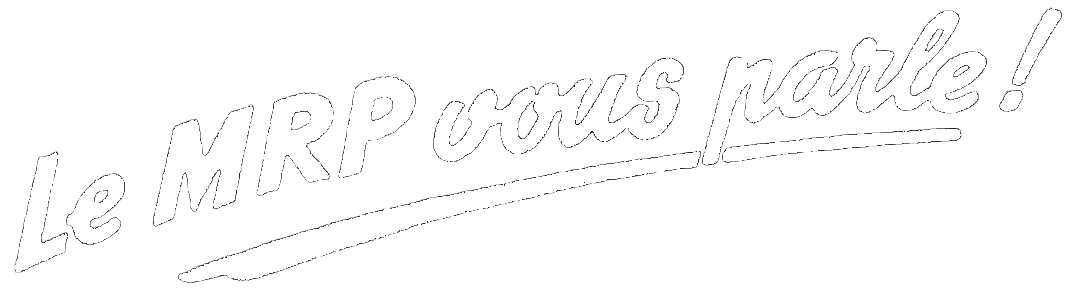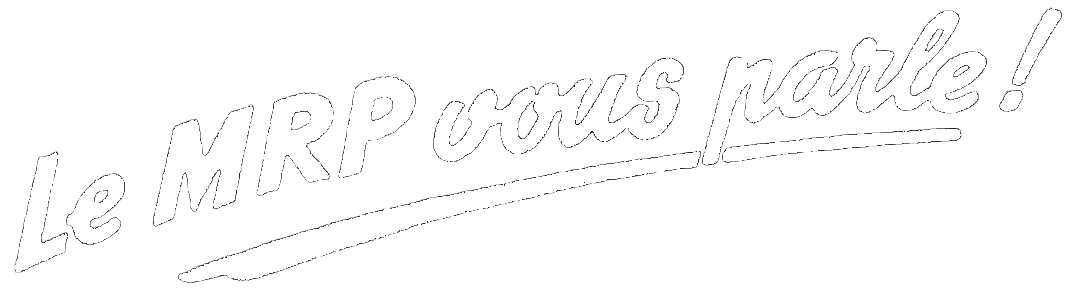|
ARCHIVES MODE EMPLOI
ARCHIVES AG
ASSEMBLEES GENERALES
|
|
|
|
|
|

|
|
|
ARCHIVES MODE EMPLOI
ARCHIVES AG
ASSEMBLEES GENERALES
|
|
|
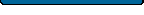
|
|
|

|
|
|
|
|
|
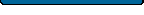
|
|
|
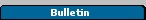
|
|
|
N° 1 du 1er trim. 1982
|
|
|
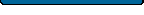
|
|
|

|
|
|
Une permanence est assurée par les membres de l'amicale du M.R.P. les :
- Jeudis de 11h00 à 17h00
A noter
-nouvel e-mail de l'Amicale:
amicalemrp@laposte.net
-N°téléphone 01 53 59 20 00
|
|
|
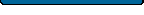
|
|
|
|